Le quartier Al Hassani, à Fès, a été le théâtre d’une tragédie dans la nuit du jeudi au vendredi, marquée par l’effondrement d’un immeuble de plusieurs étages, causant la mort de neuf personnes et faisant sept blessés, selon un communiqué des autorités locales. Le bâtiment, situé dans l’arrondissement des Mérinides, avait été classé depuis 2018 parmi les structures présentant un risque élevé d’effondrement, sans que tous les habitants aient quitté les lieux.
Dans une première déclaration officielle, la ministre de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Fatima-Zahra Mansouri, a exprimé sa « profonde tristesse » face à cette catastrophe, en présentant ses condoléances aux familles des victimes. Elle a rappelé que l’immeuble avait été formellement classé comme dangereux sur la base de données « techniques et scientifiques rigoureuses », et que des mesures d’évacuation avaient été prises dès 2018.
« Huit familles avaient accepté de quitter les lieux, mais cinq autres ont refusé, malgré les injonctions officielles », a précisé la ministre.
Mais sur le terrain, les raisons du refus prennent une dimension humaine et sociale plus complexe. L’un des survivants, un habitant de l’immeuble rescapé de l’effondrement, témoigne :
« L’État nous avait proposé une aide de 50.000 dirhams pour quitter nos logements. Mais avec cette somme, on ne peut rien louer de décent à Fès. C’était dérisoire. On n’avait pas le choix, on est restés. »
Un témoignage qui met en lumière le fossé entre la logique administrative et la réalité économique des habitants, pris au piège d’un parc immobilier vétuste et de ressources limitées.
Depuis le drame, les secours poursuivent les recherches sous les décombres, à la recherche d’éventuelles victimes ou survivants encore coincés. En parallèle, une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités dans cette affaire qui relance le débat sur la gestion des bâtiments menaçant ruine au Maroc, et l’efficacité des politiques de relogement.












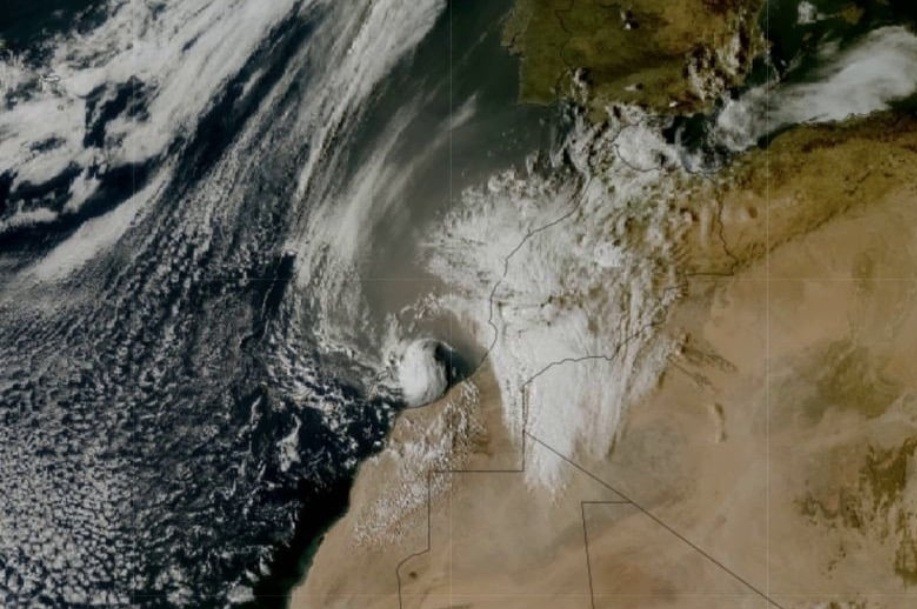



 Contactez Nous
Contactez Nous