La chambre criminelle de la Cour d’appel de Rabat, spécialisée dans les affaires de terrorisme, a rendu son verdict lundi soir dans l’affaire Hicham Jerando, condamné à 15 ans de prison ferme par contumace. Il a été reconnu coupable de formation d’une bande terroriste, d’appels publics au meurtre et d’incitation explicite à des actes terroristes visant notamment l’ex-procureur général du Roi, Najim Bensami.
Le dossier a pris une tournure inquiétante depuis le dépôt, en mai 2023, de deux plaintes par l’ancien haut magistrat. La première, déposée au Maroc, dénonçait des menaces de mort et des appels à l’assassinat dans un cadre terroriste ; la seconde, devant la justice canadienne, demandait réparation pour les mêmes faits, à la suite de contenus diffusés par Jerando sur ses réseaux sociaux, notamment des vidéos et messages d’une extrême violence.
Dans l’un de ces enregistrements, Jerando appelle clairement à “tuer Najim Bensami plusieurs fois”, allant jusqu’à imaginer le faire « ressusciter pour le tuer à nouveau », une déclaration glaçante qui a été versée au dossier comme élément constitutif d’incitation directe au meurtre avec une intention terroriste.
Plus encore, l’accusé a publié des informations personnelles et des photos de Najim Bensami et de ses enfants, facilitant potentiellement leur localisation par des groupes extrémistes. Cette démarche a été qualifiée par la Cour de provocation explicite à des actes de violence ciblée, mettant en péril la vie du plaignant et de ses proches.
À travers ses déclarations, Jerando reprend les codes du terrorisme individuel, tel que théorisé par des groupes comme Daech, dans une forme de « djihad numérique » par la parole, qui fait de la diffusion de la peur et de l’appel au passage à l’acte une stratégie à part entière.
Mais au-delà du fond, c’est la forme qui interpelle : un homme, seul face à son téléphone, se filme et diffuse des menaces de mort, s’appuyant sur des messages prétendument reçus, souvent sans la moindre preuve, et qui pourraient être motivés par des règlements de comptes personnels ou des ressentiments enfouis. Une dérive devenue banale sur les réseaux sociaux, où l’anonymat ou la distance géographique offrent un faux sentiment d’impunité.
Des sources proches du dossier révèlent que le lien de causalité entre les vidéos publiées par Jerando et les menaces réelles reçues par Najim Bensami est établi, plusieurs messages anonymes ayant été signés par des groupes terroristes se revendiquant ennemis du magistrat en raison de son action contre l’extrémisme.
Le tribunal a également été saisi par la défense de Bensami pour mettre en place des mesures de protection renforcées, estimant que les actes de Jerando ont pu encourager de potentielles tentatives d’agression à l’encontre du plaignant, de ses enfants et de ses proches.
Ce jugement, salué par de nombreux observateurs, est perçu comme un signal fort : la justice ne peut tolérer que ses représentants fassent l’objet de menaces graves et d’incitations à la haine sous couvert de liberté d’expression. Il rappelle surtout qu’on ne peut pas transformer les plateformes numériques en tribunaux sauvages, où il suffirait de lever le ton et de s’inventer une mission pour appeler à la violence sans preuve, sans cadre et sans conséquence.
Enfin, la procédure lancée au Canada suit toujours son cours, renforcée par une décision récente qui a contraint Jerando à retirer des vidéos diffamatoires dans une autre affaire. Tout semble indiquer que la justice canadienne pourrait, elle aussi, rendre un verdict défavorable à l’accusé, dans ce qui est devenu un exemple symptomatique des dérives dangereuses de certains usages des réseaux sociaux.
Ce verdict lourd rappelle enfin une vérité fondamentale : la liberté d’expression ne saurait devenir une arme de destruction morale ou physique. À l’ère numérique, il est devenu trop simple de se placer devant une caméra de smartphone, de se proclamer justicier autoproclamé et de lancer des accusations graves, souvent sans la moindre preuve, en s’appuyant sur des « messages reçus », des « confidences anonymes », ou pire encore, des règlements de comptes personnels maquillés en vérités absolues.
Cette dérive, où la parole publique devient un outil de haine, menace la stabilité, la sécurité et l’honneur de ceux qui œuvrent dans les institutions, au service de la loi. La justice, en sanctionnant de manière exemplaire ces dérives, réaffirme qu’on ne peut impunément substituer l’idéologie à la preuve, ni le ressentiment à la responsabilité. Car derrière l’écran, il y a des vies — et parfois, des cibles.















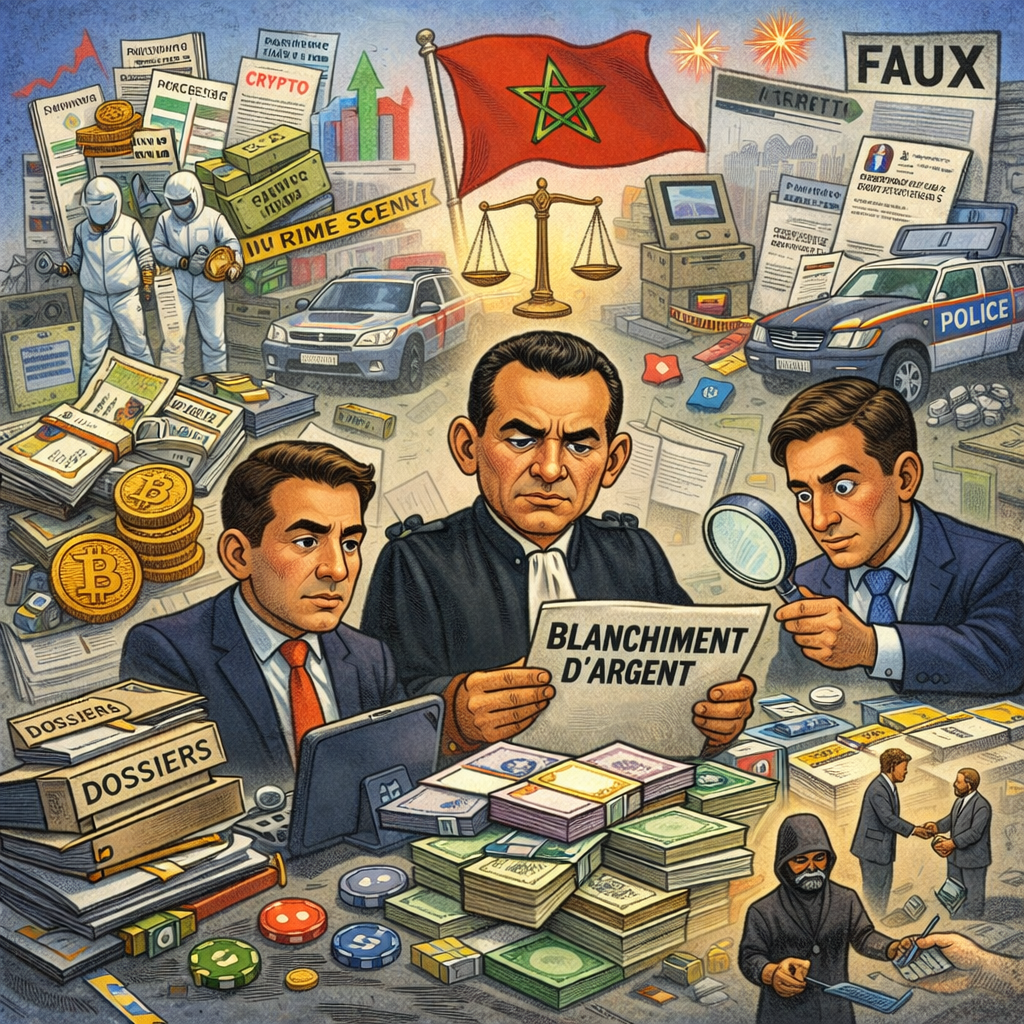

 Contactez Nous
Contactez Nous
Ceux qui osent dénoncer la COREUPTION et l’ABUS DE POUVOIR., l’impunité de certains IRresponsables…seront JUGÉS par un simple « Allô…., donnez lui 10, 15 ou 20 ans pour qu’il se taise »….
Le TERRORISME qui menace la liberté d’expression….
15 ans de prison ferme par contumace. Il a été reconnu coupable de formation d’une bande terroriste, d’appels publics au meurtre et d’incitation explicite à des actes terroristes visant notamment l’ex-procureur général du Roi, Najim Bensami…
Il était temps
kilo