Le roi Mohammed VI a ouvert, ce vendredi 10 octobre 2025, la session d’automne du Parlement à Rabat, dans un contexte de forte attente sociale. Son discours, prononcé devant les deux Chambres et retransmis en direct, a appelé les députés à « travailler avec sérieux » et à défendre, en priorité, les intérêts des citoyens, au-dessus de toute rivalité partisane ou sectorielle. Le Souverain a insisté sur l’absence de « concurrence » entre les grands projets lorsque l’objectif demeure la croissance et l’amélioration tangible du quotidien.
Le message royal fixe une boussole claire : accélérer le rythme du « Maroc qui s’élève » par un nouveau cycle de développement territorial, afin que chacun bénéficie des fruits de la croissance. L’égalité des chances passe, a souligné le Souverain, par la lutte effective contre les disparités entre territoires et par la montée en gamme des services essentiels. Il s’agit là d’un choix stratégique, non d’un slogan : santé, éducation et emploi doivent avancer de concert, avec une attention particulière aux zones les plus vulnérables — montagnes, oasis — et à la bonne activation des mécanismes de développement durable sur l’ensemble du littoral.
Le discours met également l’accent sur l’encadrement des citoyens et la pédagogie de l’action publique : expliquer, accompagner, dialoguer. Cette responsabilité ne relève pas des seules autorités administratives ; elle incombe aussi aux partis, aux élus, aux médias et, plus largement, à toutes les forces vives du pays. L’objectif : retisser la confiance autour de politiques concrètes et mesurables, au service d’une mobilité sociale plus équitable.
Cette feuille de route intervient alors que des mobilisations menées par des jeunes réclament davantage d’efforts en matière de santé, d’éducation et de redevabilité publique. Les dernières semaines ont mis en lumière une demande de résultats rapides et d’égalité territoriale ; le Palais rappelle, en réponse, que l’accélération des programmes sociaux et des projets locaux est désormais une exigence nationale.
En filigrane, le Souverain place le Parlement face à son rôle : convertir les orientations en lois, budgets et contrôles efficients, pour faire du « Maroc ascendant et solidaire » la norme vécue, et non la promesse reportée.
Par Mounir Ghazali












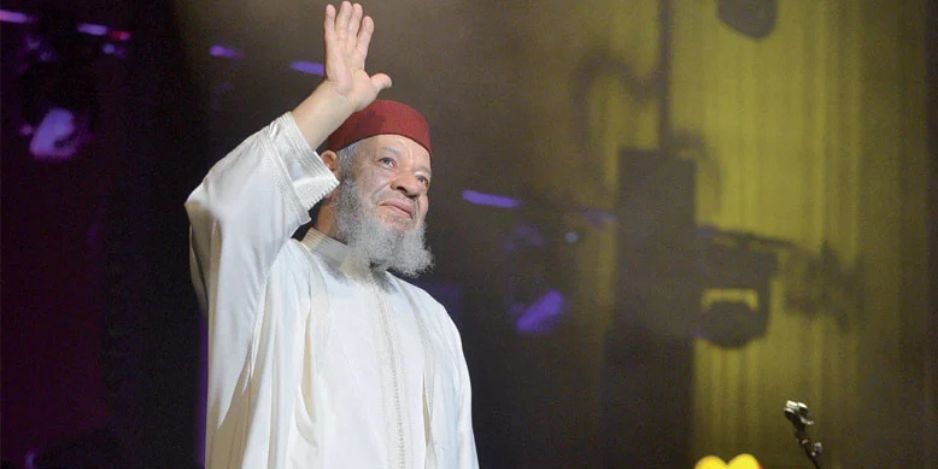

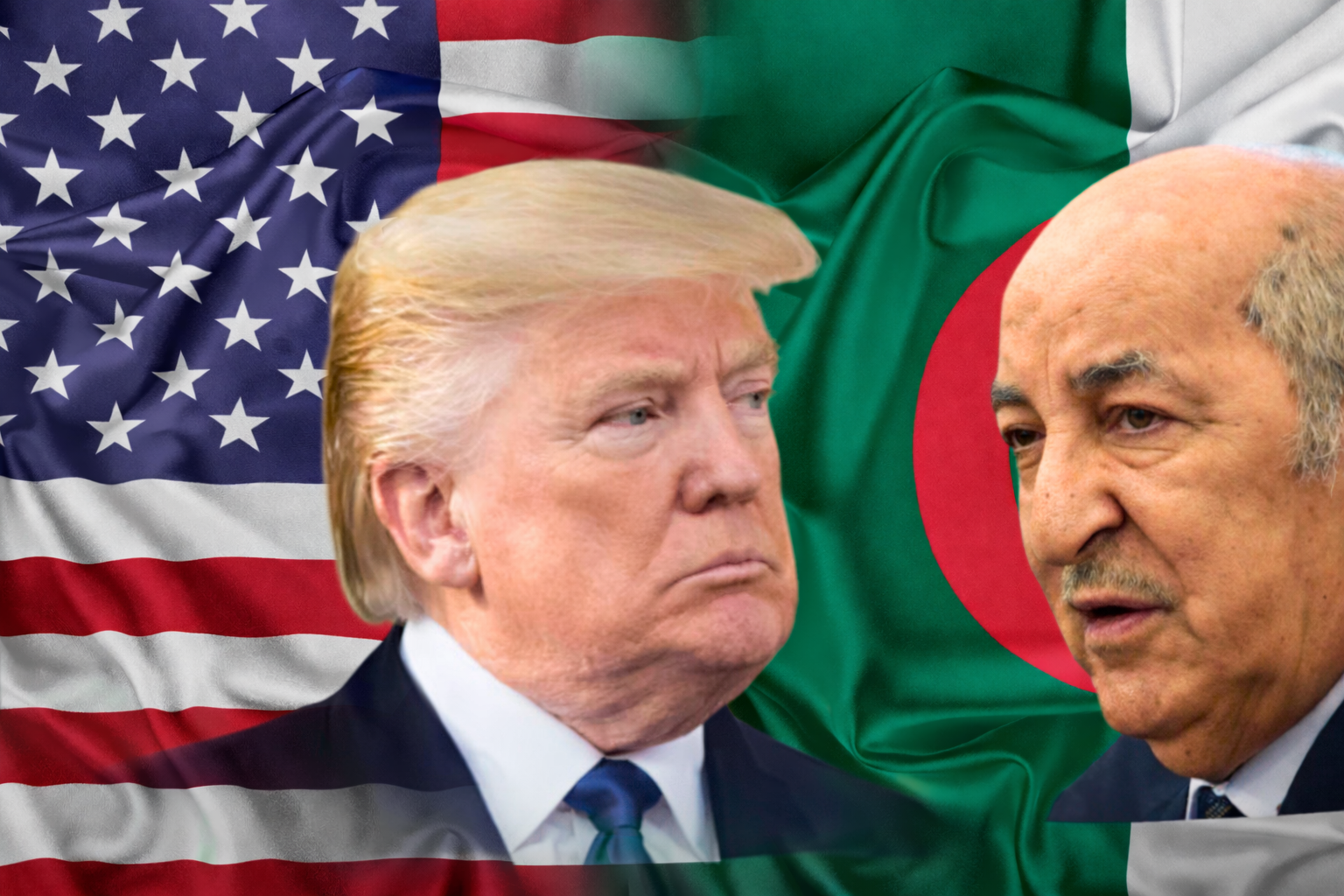

 Contactez Nous
Contactez Nous
« 𝐍𝐨𝐮𝐬 » 𝐬𝐚𝐧𝐬 « 𝐄𝐮𝐱 » : 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐫𝐨𝐲𝐚𝐥𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐞̀𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐦𝐨𝐝𝐞 𝐝’𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐢
Par Fouad El Mazouni
Un discours d’ouverture du Parlement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste. solennel et codifié, tombe au cœur d’une séquence de rue portée par GENZ212. Jeunesse connectée, demandes nettes : école, santé, emploi, probité. Le souverain ne nomme pas la rue et choisit une autre porte d’entrée. Il recentre. Il presse l’exécutif. Il place l’éducation et la santé au premier plan. Le message est clair : accélérer l’action sociale et territoriale, sans dramatisation, sans duel symbolique.
𝐒𝐜𝐞̀𝐧𝐞𝐬, 𝐫𝐨̂𝐥𝐞𝐬, 𝐩𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬
La scène est réglée. Hémicycle, formules rituelles, « Avec l’aide du Seigneur ». L’ethos se pose d’emblée : arbitre, continuité, cap. Le « Nous » est double. Majesté, mais aussi inclusion. Le « vous » vise les élus. À eux de terminer les processus législatifs, d’exercer le contrôle, d’être le relais sur le terrain. Le conflit n’est pas mis en spectacle. Il est traduit en responsabilités concrètes. Même à l’international, l’écho retient trois urgences : emploi des jeunes, services publics, fracture régionale. La mention des montagnes et des oasis ancre le discours dans des lieux précis, presque une carte des manques.
𝐋𝐞 𝐥𝐞𝐱𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐫𝐞𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞
La colère change de langue. On passe aux mots de la gouvernance : justice sociale, justice territoriale, efficacité de l’investissement public, culture du résultat, données, numérique. La dispute politique devient un problème d’exécution. On ne refait pas l’architecture. On corrige ses circuits, ses goulets, ses lenteurs. Les thèmes sensibles restent présents, école et santé en tête, mais on les présente comme des chantiers à livrer, pas comme des totems idéologiques.
𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥, 𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞
𝐔𝐧𝐞 𝐩𝐡𝐫𝐚𝐬𝐞 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐩𝐢𝐯𝐨𝐭 : « 𝐢𝐥 𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐫𝐚𝐢𝐭 𝐲 𝐚𝐯𝐨𝐢𝐫 𝐧𝐢 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨𝐦𝐢𝐞 𝐧𝐢 𝐫𝐢𝐯𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐮𝐱 ». Le texte s’attaque à une dissonance qui circule dans les slogans. D’un côté, la vitrine internationale, stades et horizons 2030. De l’autre, le quotidien des hôpitaux et des lycées. La réponse refuse l’arbitrage à somme nulle. Elle affirme la simultanéité. Les grands chantiers continuent, et les politiques de proximité aussi. Pas de hiérarchie affichée. Le récit veut tenir les deux bouts, prestige et service au public, centre urbain et marges rurales.
𝐍𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐬𝐞𝐫
Le mouvement GenZ212 n’est pas cité. C’est un choix. Le discours traite les causes sans baptiser l’interlocuteur. Il parle d’intégrité, d’abnégation, de lutte contre les pratiques « chronophages et avides de ressources ». On vise la viscosité administrative. On promet d’attaquer ce qui bloque les budgets et ralentit les services. En parallèle, la parole réactive les médiations classiques. Partis, élus locaux, médias, société civile. L’objectif est transparent : réinstaller la chaîne représentative, alors que la coordination s’est faite ailleurs, dans des canaux horizontaux.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐬𝐬𝐞
Le centre de gravité tient dans un diptyque : justice sociale et réduction des inégalités territoriales. Pas un slogan, une orientation. Trois terrains sont mis en avant. Les zones montagneuses et les oasis, souvent oubliées. Le littoral, avec la loi et le plan national qui doivent encadrer une économie maritime créatrice d’emplois. Les centres ruraux émergents, pensés comme points d’appui pour rapprocher l’administration et les services. Nommer ces espaces, c’est fabriquer une promesse vérifiable. On pourra montrer. Ici. Là. À telle date.
𝐌𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐭 𝐦𝐞𝐬𝐮𝐫𝐞
La clausule coranique referme le texte. « Quiconque fait un bien le verra. » Horizon moral, mais aussi principe de comptabilité publique. Le discours ne prononce pas « reddition de comptes », pourtant l’idée circule. Si la culture du résultat prend, si les données remontent, si elles sont publiées, chacun verra. Des classes ouvertes, des lits, des médecins, des bus scolaires, des délais tenus. La jeunesse parle déjà ce langage là. Elle veut des chiffres et des calendriers.
𝐃𝐞𝐮𝐱 𝐚𝐧𝐠𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐨𝐫𝐭𝐬
Premier angle mort, le temps. « Accélérer » ne suffit pas. Il faut former, recruter, passer des marchés, livrer des équipements, maintenir ce qui existe. Les cycles administratifs sont lents. La rue, elle, veut des réponses rapides, visibles, datées. Second angle mort, la conflictualité. Des appels à responsabilisation politique circulent, parfois jusqu’à la demande de départ du chef du gouvernement. Le discours n’entre pas dans ce registre. Il préfère l’exhortation aux élus. Il évite d’arbitrer un contentieux direct. C’est un pari de stabilité. C’est aussi une manière de déplacer le cœur du débat : moins de scène politique, plus de chaîne d’exécution.
𝐂𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐫𝐨𝐲𝐚𝐥𝐞 #samajestéleroimohammed
Trois gestes dominent. Re-cadrer, en transformant la crise en défi d’implémentation et de rééquilibrage, pas en crise de modèle. Redistribuer la parole, avec un « vous » qui met les élus au centre du dispositif. Ancrer le désaccord dans l’espace, avec des lieux nommés qui deviennent autant d’objectifs de livraison.
𝐋’𝐞́𝐩𝐫𝐞𝐮𝐯𝐞 𝐚̀ 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫
La crédibilité ne se jouera pas dans la formule « justice sociale et inégalités territoriales ». Elle se jouera dans la vitesse et dans la preuve. Recrutements signés, services ouverts, bus en ligne, centres de santé qui répondent la nuit, équipements entretenus. Il faudra publier des indicateurs lisibles. Mois après mois. Dire ce qui est fait, ce qui est en retard, ce qui bloque, ce qui a été corrigé. Sans maquillage. Sans triomphalisme.
Au fond, c’est une affaire de cap et de compteurs. Le discours trace le cap. La rue réclame les compteurs. Si les deux se rencontrent, GenZ212 restera le nom d’un moment. Si les compteurs restent muets, le moment deviendra une matrice. Pas un hashtag, un régime d’interpellation durable. Le choix est là. Et il est mesurable.