En perte de vitesse après des semaines de forte mobilisation, le mouvement Gen Z, symbole d’une jeunesse marocaine en quête d’écoute et de changement, tente de dresser son bilan. Né d’un élan de colère contre les injustices sociales et les difficultés du quotidien, il laisse derrière lui des plaies encore ouvertes et un débat national sur l’avenir du dialogue entre gouvernants et gouvernés.
L’allocution du roi Mohammed VI à l’ouverture du Parlement, perçue comme un message adressé à cette génération sans la nommer, a été reçue comme une invitation à tourner la page de la confrontation pour ouvrir celle de la réflexion. Certains animateurs du mouvement prônent désormais une évolution vers des formes de revendication plus structurées, loin des manifestations de rue. D’autres, plus radicaux, estiment au contraire qu’il faut maintenir la pression jusqu’à l’obtention de réponses concrètes et datées sur les grandes questions sociales : justice, emploi, éducation et santé. Mais faute de leadership clair, le consensus reste introuvable.
Le mouvement paye également un lourd tribut : des morts, des blessés et des dégâts matériels liés aux débordements qui ont émaillé certaines manifestations. Si la plupart des observateurs appellent à tirer les leçons de ces événements, rien ne garantit que les mêmes erreurs ne se répéteront pas.
Certains signaux laissent penser que Gen Z pourrait continuer à manifester de manière ponctuelle, à travers des mobilisations symboliques ou des actions coordonnées sur les réseaux sociaux, pour maintenir la flamme et rappeler la nécessité d’un dialogue national.
Mais, à y regarder de plus près, le mouvement semble désormais s’essouffler. Comme une baudruche qui se dégonfle lentement, Gen Z paraît plus proche de sa fin que de son apogée — à moins d’un sursaut ou d’une réorganisation capable de transformer la colère en force de proposition.
Par Salma Semmar













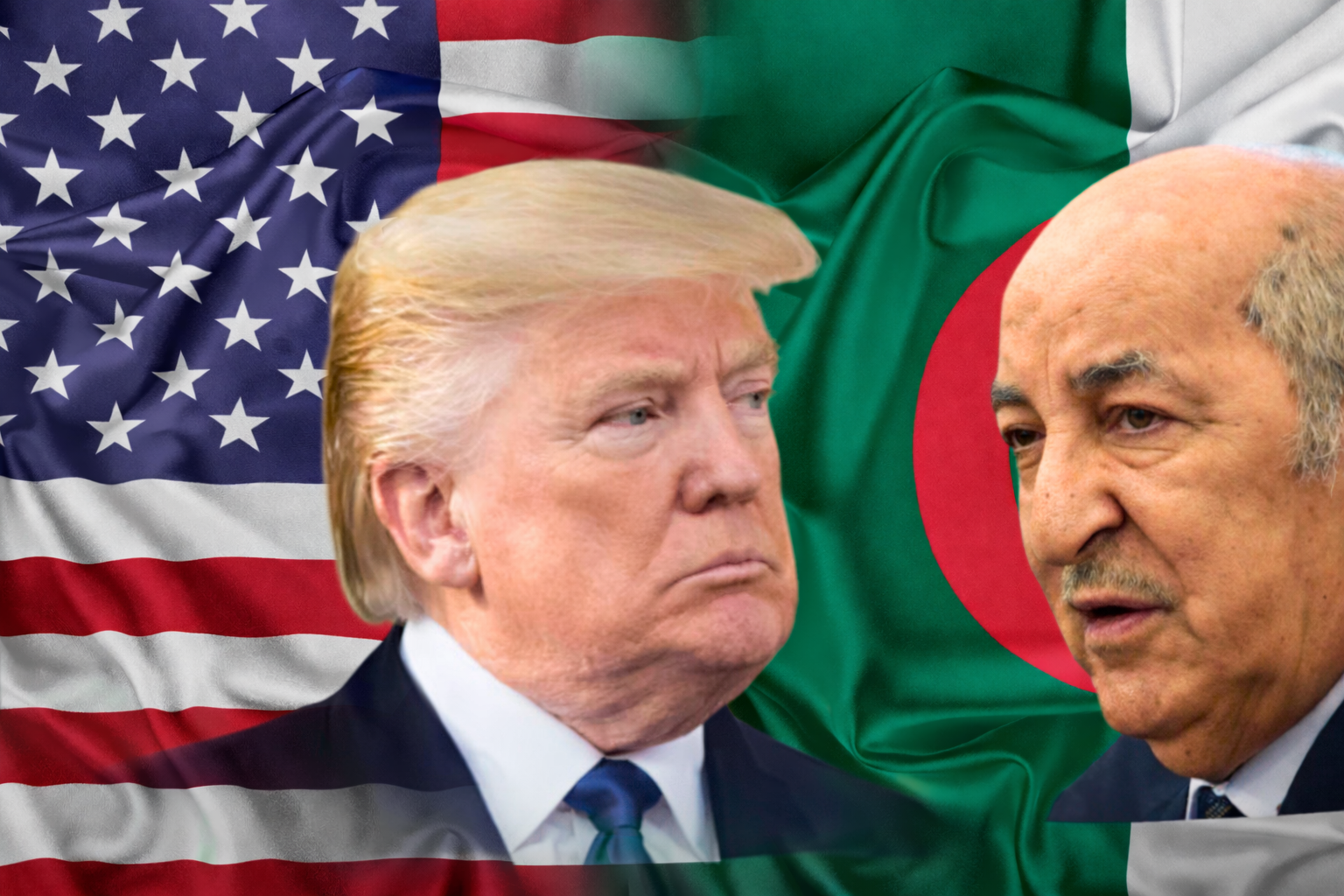

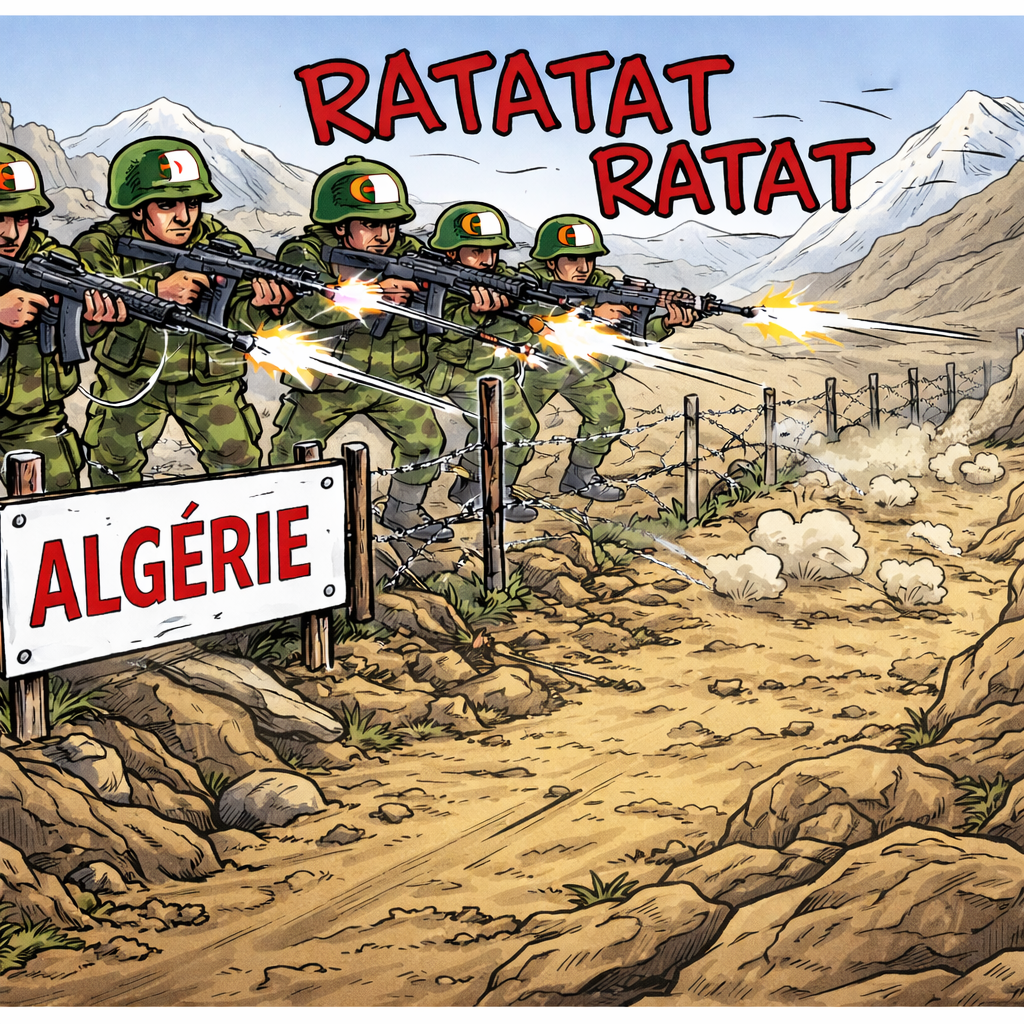
 Contactez Nous
Contactez Nous
Le monde numérique est très versatile
Message aux jeunes
Faites attention aux mains invisibles malveillantes