Malgré les nombreuses initiatives menées ces dernières années, les partis politiques marocains peinent toujours à capter l’attention – et encore moins la confiance – de la jeunesse. Ce désintérêt profond vient d’être confirmé par une étude alarmante intitulée « Entre recul et pari : l’avenir de l’influence partisane dans la culture politique au Maroc », réalisée par le chercheur Abdelhaq Haji de l’Université Hassan II de Casablanca.
L’enquête, menée auprès de 300 étudiants, révèle que 78 % d’entre eux ne considèrent pas les partis politiques comme une expression fidèle de leurs aspirations. Une statistique révélatrice d’un malaise politique profond, souvent ignoré, voire nié par les formations politiques traditionnelles.
Les raisons évoquées sont multiples, mais convergent toutes vers un même constat : les partis sont perçus comme déconnectés de la réalité des jeunes. Leur langage, leurs figures dirigeantes, leurs mécanismes internes et leurs discours semblent figés dans un modèle dépassé, inapte à dialoguer avec une génération ouverte, connectée, et nourrie aux contenus numériques.
Les périodes électorales représentent souvent le seul moment où les partis se souviennent de la jeunesse, multipliant alors les messages à leur intention. Mais en dehors de ces échéances, rares sont les preuves d’une réelle volonté d’inclusion. Les jeunes sont quasi absents des directions des états-majors politiques, ce qui renforce leur sentiment d’exclusion et de défiance.
Ce manque de représentativité alimente un déficit de participation, et interroge le rôle même des partis politiques dans la démocratie marocaine. Le risque est grand : une démocratie sans jeunesse est une démocratie sans avenir.
Les résultats de l’étude appellent à une réforme urgente et profonde du paysage politique. Moderniser les discours, renouveler les visages, ouvrir les directions aux jeunes talents, et surtout, répondre aux préoccupations concrètes : éducation, emploi, climat, libertés individuelles…
Dans ce contexte, les formations en sciences politiques prennent tout leur sens. Plusieurs universités marocaines, comme l’Université Internationale de Rabat, l’Université Mohammed V ou encore Sciences Po Rabat, offrent aujourd’hui des cursus susceptibles de former une génération plus engagée, mais encore faut-il que ces compétences trouvent un écho au sein des structures partisanes.
Le Maroc, pour garantir la continuité démocratique, devra inévitablement reconstruire un lien de confiance avec sa jeunesse. Et cela passe, d’abord, par une prise de conscience politique que les partis, jusqu’à aujourd’hui, semblent refuser d’assumer.
À l’approche des prochaines élections, une opportunité s’offre aux états-majors politiques marocains : celle de rompre avec les pratiques classiques et de tester de nouveaux procédés de communication et de mobilisation. Il est temps d’adopter un discours ancré dans la réalité des jeunes, respectueux de leur intelligence, de leurs aspirations et de leur mode de vie.
À l’inverse, les sorties publiques de certains leaders politiques, à l’image d’Abdelilah Benkirane, chef du Parti de la Justice et du Développement (PJD), ne font que creuser le fossé générationnel. Ses déclarations répétées sur la jeunesse, le mariage, le travail ou encore la place des femmes dans la société, véhiculent une vision passéiste qui heurte une génération en quête d’ouverture, de liberté et de reconnaissance.
Le renouvellement du discours politique n’est plus un luxe, c’est une nécessité. Il ne s’agit pas seulement de reconquérir les jeunes électeurs, mais de leur redonner une place légitime et active dans la vie politique nationale. Sans eux, aucune réforme durable n’est possible.
Par Jalil Nouri












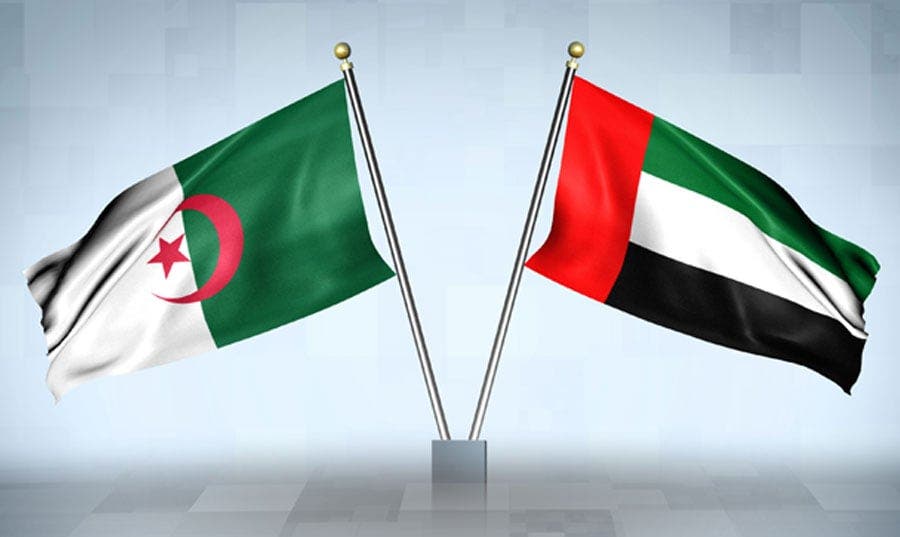



 Contactez Nous
Contactez Nous