Au Maroc, la passion pour les jeux vidéo s’est imposée comme une véritable culture de masse, au point de faire désormais partie du quotidien de nombreux jeunes. Dans les grandes villes, les espaces de gaming se multiplient, offrant du matériel de pointe et des titres de dernière génération. Ces lieux, à la fois conviviaux et lucratifs, ont remplacé les anciens cybercafés, devenus trop exigus et dépassés pour accueillir la nouvelle génération de gamers.
Si les cyber traditionnels accueillaient les adolescents dès 12 ou 13 ans, leur rareté actuelle pousse les jeunes de 18 ans et plus vers des espaces mieux équipés… mais souvent plus coûteux. Une transition générationnelle s’opère ainsi, renforcée par un engouement nourri par les succès marocains dans les compétitions mondiales d’e-sport.
L’essor de cette pratique est soutenu, dans une certaine mesure, par les orientations culturelles du gouvernement, qui ambitionne de créer une industrie nationale du jeu vidéo. Résultat : de plus en plus de jeunes rêvent de devenir les « Ronaldo du gaming », aspirant à la célébrité numérique autant que certains aspirent aux sommets du football mondial.
Mais si le talent des jeunes Marocains dans les jeux électroniques est indéniable, cette passion dévorante suscite aussi l’inquiétude. Nombre d’éducateurs et de parents alertent sur les conséquences : recul de la performance scolaire, troubles du sommeil, isolement social. Le débat s’installe : entre espoir d’ascension sociale via le gaming et crainte d’une addiction numérique, deux visions du futur s’opposent.
Au-delà de la simple passion, le gaming au Maroc est en train de devenir un véritable secteur économique et culturel en mutation. Si les chiffres précis manquent encore, les estimations font état de milliers de joueurs actifs, toutes plateformes confondues, et d’un marché en croissance continue, notamment porté par le mobile. L’État semble avoir saisi l’enjeu, en intégrant le développement de l’industrie vidéoludique dans sa politique culturelle, en encourageant l’organisation de compétitions e-sport, de hackathons, ou encore en soutenant la création de studios de jeux 100 % marocains. Des structures comme Rym Games ou Atlas Games Studio commencent d’ailleurs à se faire connaître, et des écoles ou incubateurs spécialisés voient le jour, formant une nouvelle génération de développeurs, codeurs et designers. Parallèlement, des jeunes streamers et joueurs marocains s’imposent sur les réseaux sociaux et dans les compétitions internationales, incarnant une ambition collective et moderne, et attirant des milliers de fans sur YouTube ou Twitch.
Mais cette expansion rapide soulève aussi des questions éducatives, sociales et éthiques. Des experts tirent la sonnette d’alarme face à l’addiction croissante, l’isolement social ou les troubles liés à la sédentarité. Le coût du matériel de jeu et l’accès inégal aux nouvelles technologies creusent aussi des fractures sociales entre jeunes urbains et ruraux. Si certains pédagogues reconnaissent les bénéfices du gaming en matière de logique, de réflexion ou d’apprentissage des langues, d’autres s’inquiètent de voir des adolescents délaisser leurs études au profit d’une carrière incertaine dans l’e-sport. Ainsi, le Maroc se trouve à la croisée des chemins : encadrer une passion prometteuse et potentiellement créatrice d’emplois, sans en négliger les risques pour une jeunesse en quête de repères et de reconnaissance.
Par Salma Semmar















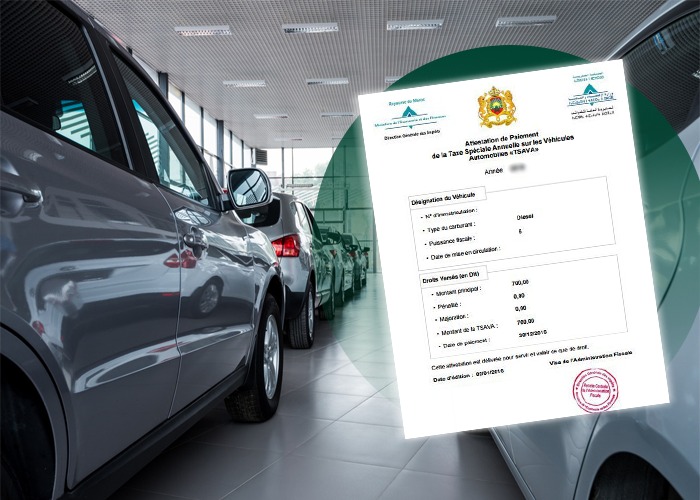
 Contactez Nous
Contactez Nous