Une fois les accolades et les communiqués optimistes passés, le naturel reviendra au galop entre la France et l’Algérie. Cette dernière n’a pas dit son dernier mot, et la première s’est trop vite contentée d’assurances qui seront aussitôt démenties, comme l’expérience l’a souvent prouvé.
La visite du chef de la diplomatie française à Alger, après huit mois de quasi-rupture diplomatique, et ses entretiens avec le président algérien, n’ont pu se dérouler qu’après l’accord des militaires, trop occupés par les tensions créées par leur aviation avec trois pays voisins — le Mali, le Niger et le Burkina Faso — suite à la destruction d’un drone malien dans l’espace aérien malien. Ce geste a poussé ces pays à rappeler leurs ambassadeurs, preuve supplémentaire de la politique aventuriste et belliqueuse de l’Algérie, qui l’amène aujourd’hui à créer un nouveau foyer de tension régional, après celui du Sahara, en s’ingérant de manière répétée dans les affaires de ces pays membres d’une même alliance.
De cette visite du ministre français des Affaires étrangères à Alger, Jean-Noël Barrot, il serait imprudent de conclure qu’elle marque l’ouverture d’« une nouvelle ère », comme l’affirme le communiqué officiel. Les problèmes n’ont pas été réglés, loin s’en faut, et il serait illusoire de croire le contraire — comme dit l’adage : « cacher le soleil avec un tamis » ou « verser de l’eau dans le sable ».
La France restera intraitable dans son soutien au Maroc dans le dossier du Sahara.
Si les militaires algériens s’opposent à la libération de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, le président algérien Tebboune ne lèvera pas le petit doigt pour accorder une grâce présidentielle, contraignant la France à réactiver les mesures d’expulsion d’Algériens.
Tous les autres contentieux — et ils sont nombreux — resteront inchangés tant que le pouvoir algérien ne changera pas et tant que l’Algérie ne fera pas table rase du passé colonial de la France dans son histoire et sa mémoire. Jusqu’à preuve du contraire.
Par Jalil Nouri
.













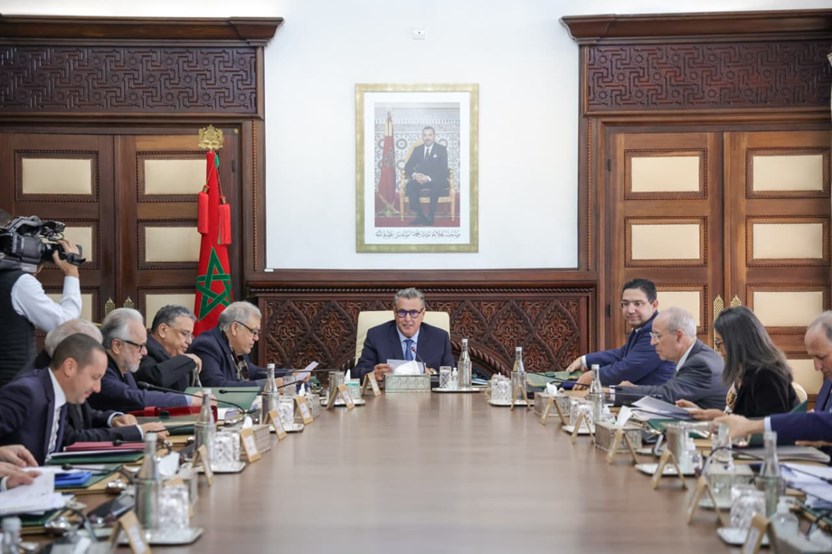


 Contactez Nous
Contactez Nous
Un esclave soumis restera toujours esclave soumis ya jalil nouri tu ne connais pas encore la liberté même si tu vis en France
Tres juste, le malheureux soumis à son maître restera sous ses pieds même s’il doit vendre son frère.
Et que vive notre dignité…
Que vaut la parole d’une dévergondée qui parle d’honneur et de dignité. Un peuple dans sa majorité fondamentalement et congénitalement abusé par plus de 4 siècles d’asservissement !
C du pur makhnez. Çà sent l mauvaises odeurs à mille lieux!!! Désornais avec les noirs africains ..ce sera l flagellation continue ..y compris les makhzeno.sionistes.lgbt ….Ils ne comprennent que l langue du plus fort comme nous l.a si bien enseigné l.histoire.Et pour rester ds l.histoire ..il est gd temps pr nos diplomates..et nos décideurs d prendre en charge t sérieusement l dossier de nos terres annexées frauduleusenent par l France ..puissance occupante..et rattachées aux « royautés » de fès et marrakech…..Et sans plus tarder. Il est temps d.asseoir nos frontières une fois pr tte…Et laisser à nos enfants des frontières suûes et perrenes…Tant q.il est possible..avant que l Roshilds et l sionisme mondial n s.installe s nos terres..et q.il sera diff..et imposs. De les déloger…..
Je n’ai rien a ajouté après ce long avis de la part d’une politique opposante au voisin algérien.
Merci de m’avoir donné
cette occasion.
Dans l’espace aérien Algérien
Exactement.c’est une précision très importante.
C’est dans l’espace aérien algérien.
Récupérer vos femmes du moyen Orient
ensuite en vous donne la parole..
Tu parles de طاكوسات algechienne demande a amir dz il a la preuve et encore pur sous le haut patronage du régime algechien .
Allez faire la fil et attend ta sœur de retour du Khalij ou du village lafet .
Si tu parlais plus de ton pays et de ses problèmes que de l Algerie
Commences a balayer devant ta porte
En Algérie nous n’avons rien à perdre, au contraire se débarrasser des anciens réflexes paternalistes de certains politiques français en coupant les liens inutiles qui favorisent la mainmise française sur l’économie et les affaires internes algériennes, l’Algérie est libre de choisir ses partenaires et tirera profit de ses richesses. Au moment où les pays africains anciens colonies de la France coupent les amares, une Zriba voisine renouvelle ses engagements de sous-traitance sbiristes, et comme dit le dicton bien en vogue à la Zriba du Makhzen » La pute veut voir toutes les femmes devenir comme elle « .
Cela ne vous regarde pas ! Chacun s’occupe de ses oignons et les vaches seront bien gardées.
En lisant cet article je pensais a un avis d Expert en revanche j ai eu la sensation d une série de fausses informations et d un ton venimeux dommage vous etes indigne d etre journaliste
Un expert bien rémunéré par les bidasses qui s’exprime pour défendre une horde d’hyénes qui ferait mieux d’aller grossir les files de quemandeurs de sachets de lait !
Merci à tous les DèZesespères KERGOULIS toujours aveuglé par leur gros nif et bien endoctriner par les généraux putschistes installés par maman frança avant son départ de la Zriba. Vivent KEDBOUNE et KHANEZ RIHA Ne changez pas, restez comme vous êtes un pays riche en gaz et pétrole et un peuple qui souffre de toutes les pénuries possibles et encore merci d’être là RISÉE DU MONDE.
vous êtes pathétiques lecture poubelle tellement vous avez peur de votre mahnez vous racontez a vos pauvres lecteurs que des mensonges n’oubliez pas beaucoup de marocaine sont dans une situation bien pire en France et surtout Belgique , et votre colonisateur de ce jour l’Espagne n’en parlons pas alors basta vos mensonge poubelle
Le peuple algérien bien soudé plus que jamais avec son armée.