Ce lundi 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a ouvert le procès du scandale immobilier Apollonia, l’un des plus retentissants jamais connus en France. Un procès hors normes pour une escroquerie estimée à près d’un milliard d’euros et qui met en cause 15 prévenus – dont un avocat, trois notaires, des commerciaux et la société Apollonia elle-même. Le Maroc figure parmi les pays concernés par les ramifications de cette affaire tentaculaire.
Une fraude aux allures de système bien huilé
Créée dans les années 2000 par Jean Badache, son épouse et leur fils, la société Apollonia, installée à Aix-en-Provence, proposait à ses clients des investissements immobiliers « clés en main », censés être autofinancés grâce aux loyers perçus. L’offre promettait des avantages fiscaux attractifs, un montage bien ficelé, et des rendements assurés.
Mais derrière ce discours commercial séduisant se cachait un système de fraude massif. Des commerciaux, appuyés par des notaires et un avocat, incitaient les clients à souscrire plusieurs prêts bancaires sur la base de documents falsifiés. Les biens vendus étaient surévalués de 70 à 100 %, selon les victimes. Au lieu de générer des revenus locatifs suffisants, les investisseurs se retrouvaient surendettés, étranglés par l’effet cumulatif des crédits contractés.
Entre 2002 et 2010, Apollonia a vendu plus de 5 000 lots immobiliers, pour un montant avoisinant le milliard d’euros. Le scandale a éclaté en avril 2008, après les premières plaintes déposées auprès du parquet de Marseille. L’information judiciaire a révélé une organisation digne d’un réseau criminel, avec blanchiment, usage de faux et escroquerie en bande organisée.
Le Maroc, maillon d’un réseau international
Au-delà des frontières françaises, l’enquête a mis en lumière l’existence de ramifications internationales, notamment au Maroc, où des saisies ont été opérées. Des biens immobiliers et objets de luxe appartenant à certains prévenus y ont été identifiés et gelés dans le cadre de la procédure judiciaire, aux côtés d’avoirs situés en Suisse et au Luxembourg.
Le Maroc apparaît ici non pas comme simple décor lointain, mais comme territoire d’investissement ou de dissimulation d’avoirs potentiellement frauduleux. Le fait que des fonds issus de cette fraude aient été placés ou blanchis sur le territoire marocain soulève des questions sur les mécanismes de contrôle et de coopération judiciaire entre les deux pays.
Cela souligne également une réalité bien connue : le Maroc, comme d’autres pays, attire certains investissements immobiliers ou achats de biens de prestige, parfois utilisés pour cacher ou recycler des fonds illicites. La coopération judiciaire internationale a permis de retracer ces flux financiers, et les autorités marocaines ont collaboré à l’enquête en procédant aux saisies demandées par la justice française.
Un procès colossal et symbolique
Face à cette escroquerie de masse, les chiffres donnent le vertige :
-
762 victimes se sont constituées parties civiles
-
110 avocats les représentent
-
Le procès devrait durer plus de trois mois, jusqu’au 6 juin 2025
-
Les prévenus risquent jusqu’à 10 ans de prison et 1 million d’euros d’amende, tandis que la société Apollonia encourt jusqu’à 5 millions d’euros d’amende
Pour les victimes, c’est plus qu’une simple affaire judiciaire. « Notre rêve a été complètement cassé », témoigne l’un des investisseurs floués, qui espérait assurer sa retraite ou constituer un patrimoine pour ses enfants. Beaucoup d’entre eux vivent encore les conséquences de cet effondrement financier : dettes, saisies, fichage bancaire…
Un signal fort pour le secteur immobilier
Ce procès, au-delà des condamnations attendues, pose aussi la question de la surveillance du secteur de l’immobilier défiscalisé. Il met en cause non seulement une société commerciale mais aussi des professions réglementées, telles que notaires et avocats, censées garantir la sécurité juridique des transactions. Leur implication dans ce système renforce la gravité de l’affaire.
Le volet marocain, quant à lui, rappelle la nécessité d’une vigilance accrue sur les investissements internationaux et les risques de blanchiment d’argent par le biais de biens immobiliers. Il témoigne aussi d’une interconnexion croissante entre les délits économiques transnationaux et les circuits de l’immobilier.















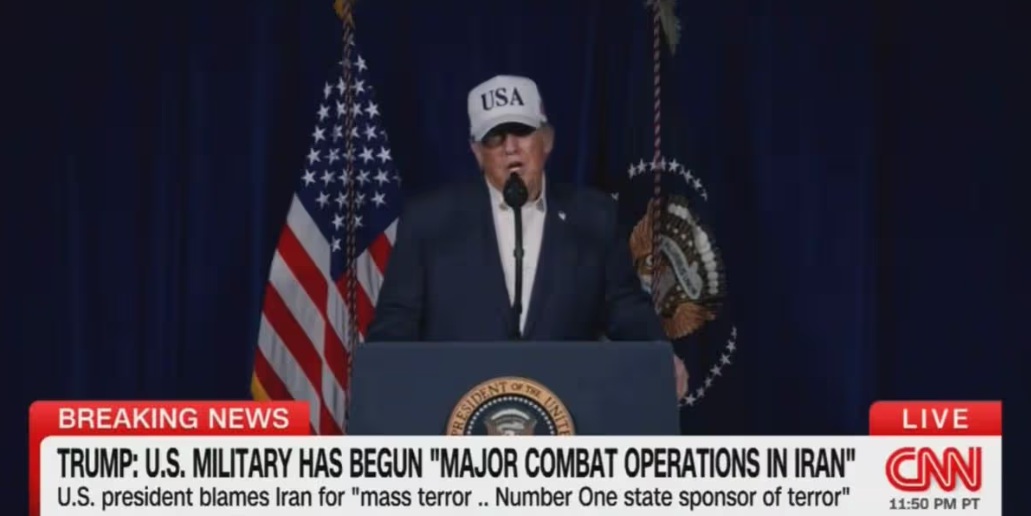
 Contactez Nous
Contactez Nous
Sur la photo, on peut observer une famille d’escrocs bien tranquille et tres relax: en effet, pour des Israéliens, ils ne risquent rien, même s’ils ont dépouillé des retraités qui vont chuter dans la grosse misère (j’espère toutefois qu’ils ne vont pas se suicider), ils n’auront même pas assez de revenu pour se soigner…mais la politique des politiciens dominent l’intérêt du peuple’