Le problème de l’abstention des jeunes aux élections législatives n’est pas nouveau. Depuis des décennies, il alimente les inquiétudes des observateurs, des partis et des institutions. Mais à l’approche des élections de 2026, les autorités semblent décidées à inverser la tendance, conscientes que les méthodes appliquées jusqu’ici n’ont donné aucun résultat probant.
Un poids électoral déterminant mais inexploité
Dans un pays où la population est majoritairement jeune, cette abstention massive est un paradoxe dangereux. Elle prive la vie politique de l’énergie et des idées d’une partie essentielle de la société et influence négativement l’orientation des politiques publiques. Les chiffres sont parlants : les électeurs de moins de 35 ans représentent une proportion décisive du corps électoral, capable de peser lourdement sur la composition du Parlement et les choix stratégiques du pays.
Pourquoi les jeunes boudent les urnes ?
Pour se justifier, beaucoup avancent un constat amer : une vision négative de la pratique politique et de ses acteurs. Les critiques récurrentes pointent l’inefficacité des gouvernants, leur conservatisme, et l’exclusion persistante des jeunes – même les plus qualifiés – des instances décisionnelles. À cela s’ajoutent des freins structurels : manque d’éducation civique dans les programmes scolaires, absence de campagnes ciblées sur les réseaux sociaux, ou encore méconnaissance des procédures de vote.
Que peuvent faire les partis et les autorités ?
Le ministère de l’Intérieur prépare ses propres propositions, qui seront discutées avec les partis politiques. Mais pour susciter un véritable sursaut, il faudra aller au-delà des discours. L’exemple de certains pays comparables montre que des solutions existent : vote électronique, réduction de l’âge légal du vote à 16 ans, campagnes de sensibilisation massives, ou mobilisation d’influenceurs pour toucher le public jeune.
Le rôle de la société civile et la nécessité de représentativité
Les associations, ONG et mouvements citoyens peuvent aussi jouer un rôle clé, en agissant comme passerelles entre les institutions et les jeunes. Par ailleurs, mettre davantage de jeunes candidats sur les listes – en positions éligibles – renforcerait le sentiment de proximité et de confiance.
Conclusion : de la désaffection à l’action
Certains pays ayant connu des niveaux similaires de désaffection ont réussi à réintégrer les jeunes dans le processus démocratique en adoptant des stratégies innovantes. Le Maroc ne pourra prétendre à un développement solide et inclusif qu’en réconciliant sa jeunesse avec les urnes. Les élections de 2026 seront un test décisif : soit elles marquent un tournant vers l’inclusion politique des jeunes, soit elles confirmeront un fossé générationnel qui fragilise l’avenir démocratique du pays.
Par Salma Semmar




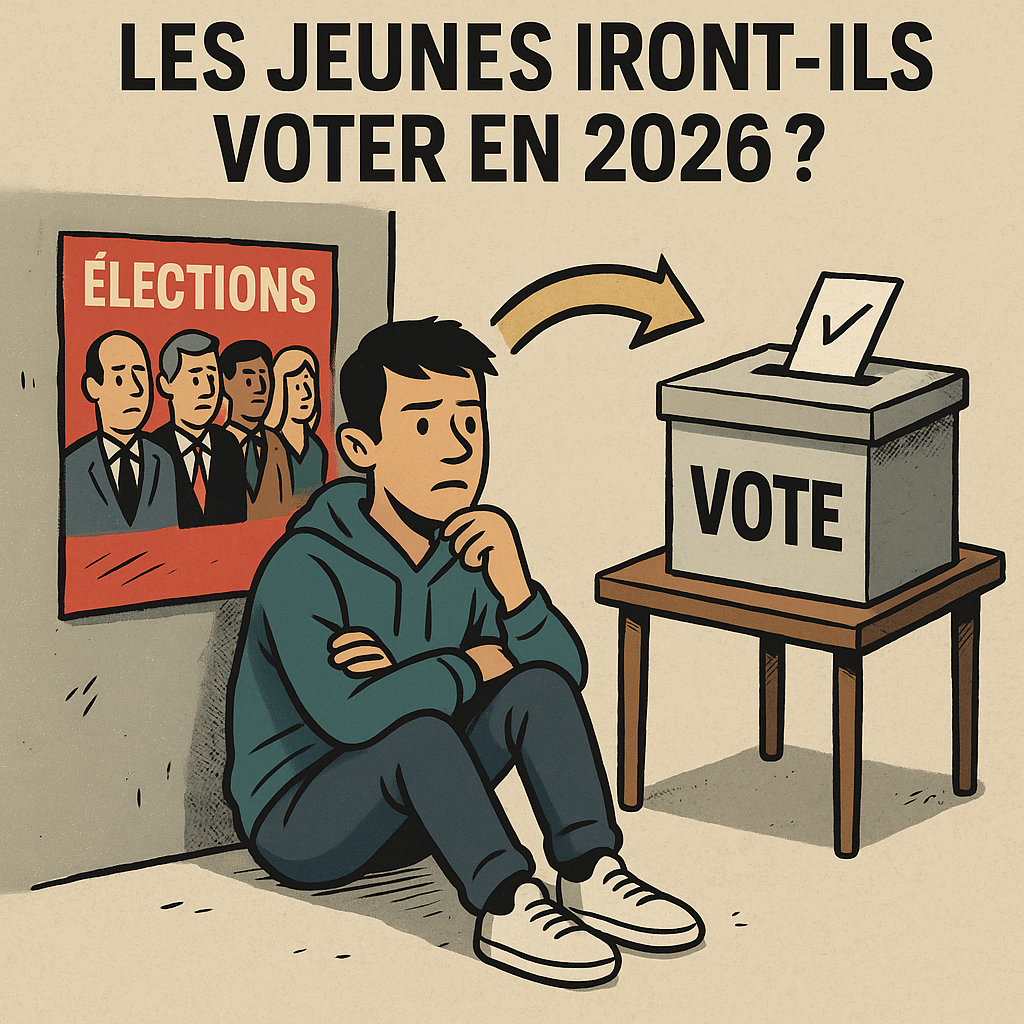







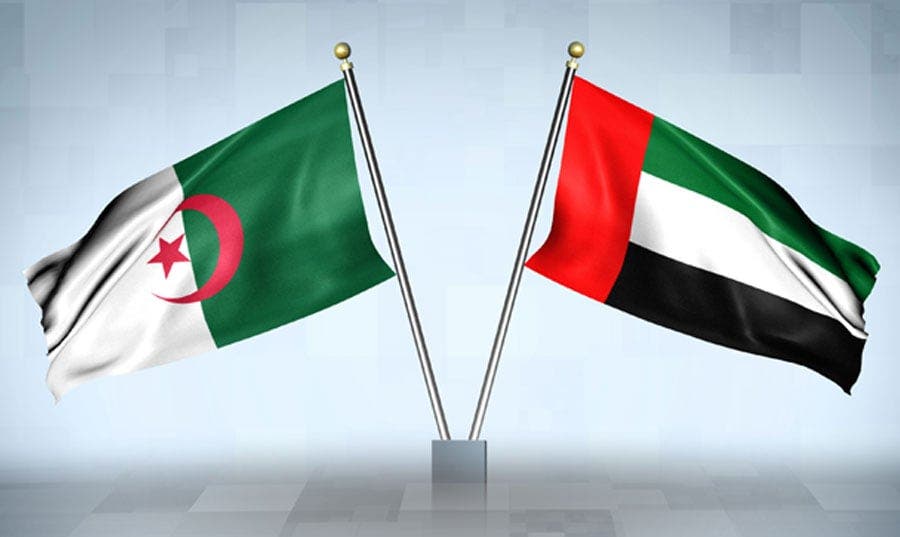



 Contactez Nous
Contactez Nous