ment une nuit de stupeur et d’incompréhension qu’ont vécue les organisateurs de la 13e Nuit blanche du cinéma et des droits de l’Homme, à Rabat, ce vendredi 4 juillet. Alors que tout était fin prêt pour accueillir le public sur l’esplanade de la Bibliothèque nationale du Royaume, les autorités locales ont interdit au dernier moment la tenue de l’événement, sans explication publique.
Écran installé, tapis déroulés, chaises alignées, projecteurs testés… L’équipe de l’Association des Rencontres Méditerranéennes du Cinéma et des Droits de l’Homme (ARMCDH) avait tout préparé avec minutie. Sauf peut-être l’impensable : l’arrivée des forces de l’ordre, venues empêcher la projection des films et disperser les techniciens présents sur les lieux.
Un véritable choc pour l’association, habituée à organiser cette veillée cinématographique depuis treize ans. Le rendez-vous est soutenu par des institutions nationales et internationales comme ONU Femmes Maroc, l’Institut français ou encore la Fondation Heinrich Böll, et devait réunir des centaines de cinéphiles autour de neuf films engagés, venus de huit pays, pour parler de mémoire, de dignité et de justice sociale.
À l’heure où le cinéma est célébré ailleurs comme à Khouribga pour le FICAK, où la diversité du continent africain est mise à l’honneur, l’interdiction soudaine de cet événement à Rabat suscite de vives interrogations sur la liberté d’expression culturelle, d’autant plus que la thématique de cette édition portait précisément sur la citoyenneté active et l’éducation aux droits fondamentaux.
Prévu également, un débat à la Faculté des lettres réunissant Driss El Yazami, Leila Rhiwi et Abderrazzak El Hannouchi, autour de la sociologue Khadija Berady, avait pour ambition d’explorer le rôle du cinéma comme gardien de la mémoire collective.
Aujourd’hui, c’est la mémoire de cette nuit empêchée qui s’ajoute au combat. L’ARMCDH exprime sa profonde déception, mais entend continuer à faire du cinéma un outil d’éveil, de dialogue et de résilience, même dans l’adversité.















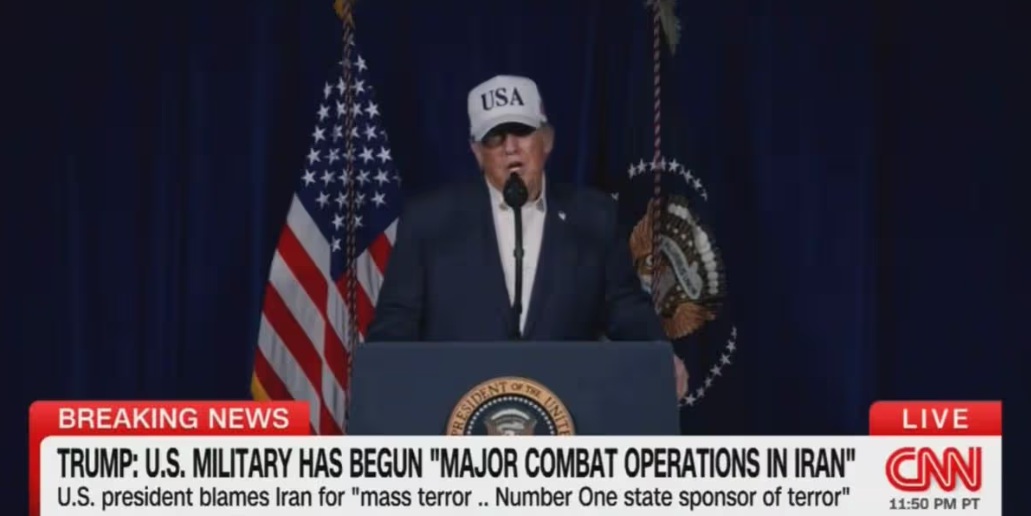
 Contactez Nous
Contactez Nous