Le signal est sérieux. Devant la Chambre des conseillers, mardi, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a dressé un bilan alarmant des retenues : le taux de remplissage des barrages est tombé à 32 %, contre 40 % en mai. En cause, la priorisation des volumes pour l’agriculture et l’eau potable, mais aussi une évaporation record estimée à 650 millions de m³ sous l’effet des vagues de chaleur.
Malgré des pluies en légère amélioration sur la dernière campagne (moyenne nationale 142 mm) et 4,8 milliards de m³ mobilisés (+50 % sur un an), le déficit persiste : ces apports restent 22 % sous la normale, avec un manque de 58 % par rapport à la moyenne historique. Résultat : un pays sous stress hydrique structurel, où le niveau agrégé demeure à 32,4 %, soit 5,44 milliards de m³ stockés, avec des disparités régionales marquées.
Barrages : accélération des chantiers
Face à l’urgence, l’Exécutif met en avant une stratégie de sécurisation pluri-échelle. Depuis 2021, six grands barrages ont été mis en service — Kaddoussa (Errachidia), Tiddas (Khémisset), Todgha (Tinghir), Agdez (Zagora), Fask (Guelmim), M’dez (Sefrou) — et les remplissages de Koudiat Borna (Sidi Kacem) et Ghis (Al Hoceïma) ont démarré. Quatorze autres grands barrages sont en construction, et onze supplémentaires sont programmés entre 2025 et 2027. Quatre barrages moyens avancent en parallèle (Tassa Ouirgane, Msalit, Aïn Ksob, Sidi Yakoub).
Au maillage fin, 155 petits barrages sont prévus (2022-2027) dans le cadre d’un accord interministériel ; 50 sont déjà en cours. Objectif : tamponner les crues, recharger les nappes et sécuriser l’irrigation locale.
Nappes, interconnexions et dessalement
Côté eaux souterraines, 4 221 puits d’exploration ont été forés (profondeur cumulée ~671 000 m) pour un débit de 8 889 l/s. 5,8 millions de ruraux disposent aujourd’hui d’une alimentation en eau potable.
Le ministre met aussi en avant la phase urgente de l’interconnexion Sebou–Bouregreg, qui a transféré 871 millions de m³ (octobre 2023 – octobre 2025), sécurisant l’eau potable des grandes villes et bénéficiant à 500 000 ruraux. Le dessalement est érigé en pilier de résilience : 110 stations mobiles déployées et une cible ambitieuse — plus de 60 % de la population alimentée en eau dessalée d’ici 2030.
Logistique d’urgence et réalités locales
Pour soulager les zones les plus exposées, l’État a mobilisé 1 200 camions-citernes et 10 000 citernes, permettant d’approvisionner environ 2,7 millions de personnes par an. Reste la question clé : tenir dans la durée. Entre évaporation accrue, variabilité climatique, croissance de la demande et retards d’exécution, la fenêtre de manœuvre est étroite. Le cap gouvernemental combine désormais investissement massif, interconnexions, dessalement, stockage local et sobriété d’usage — autant d’axes dont l’efficacité dépendra de la vitesse de déploiement et de la coordination territoriale.













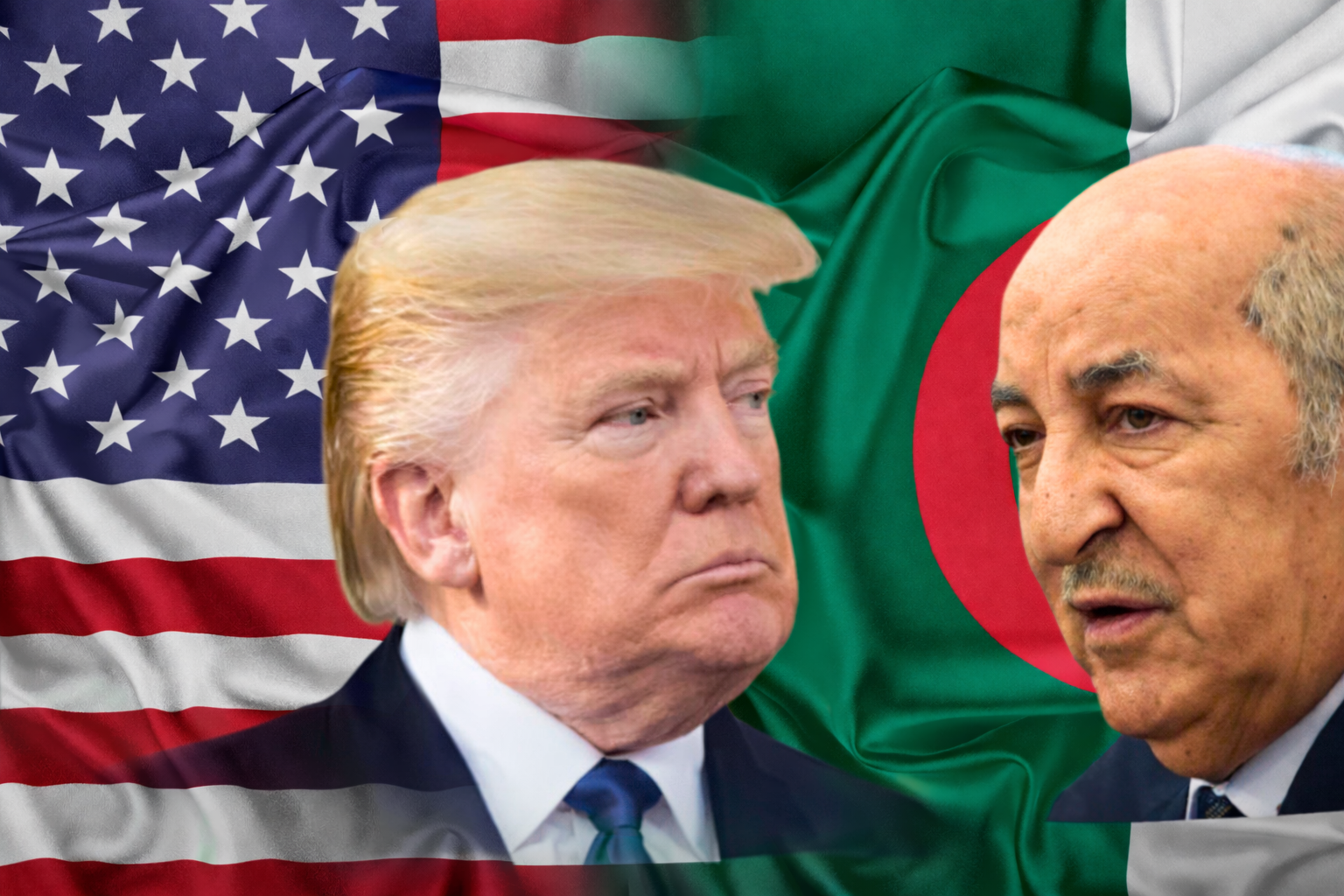

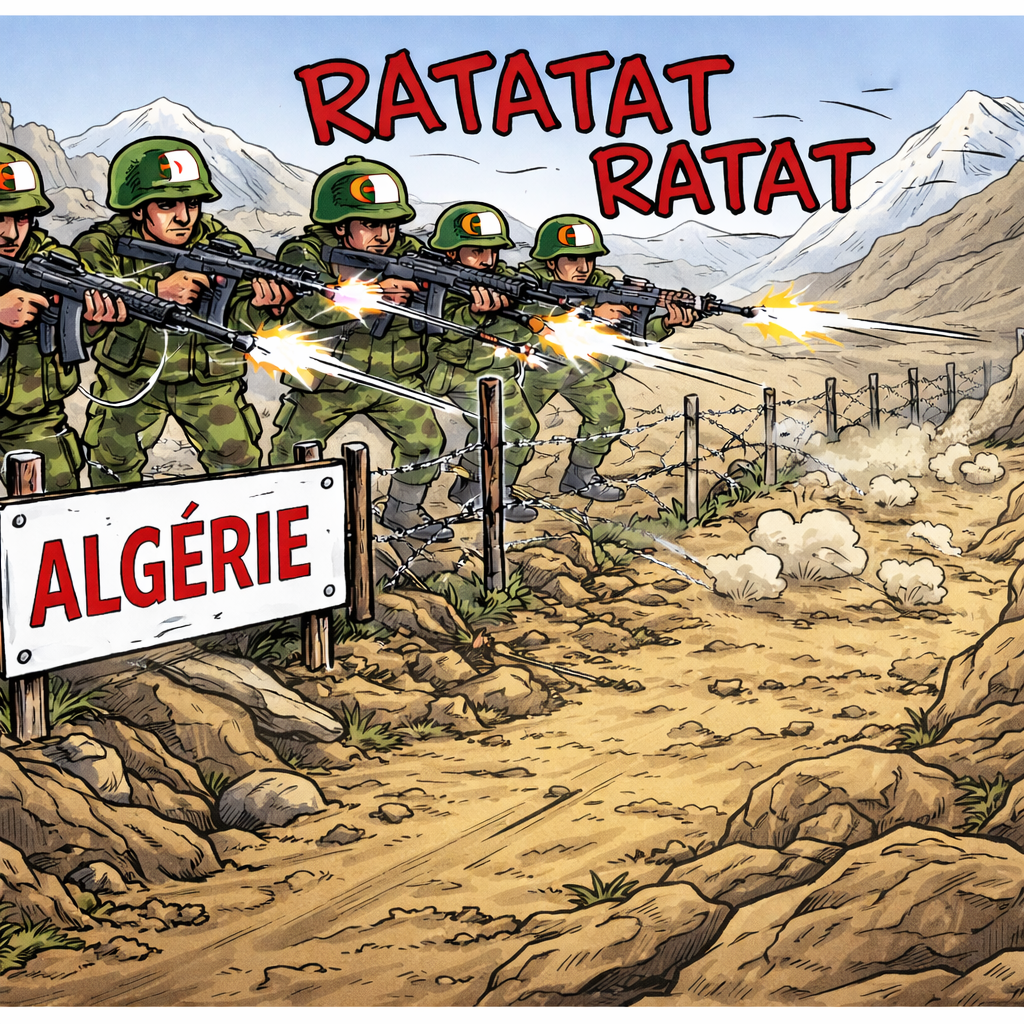
 Contactez Nous
Contactez Nous